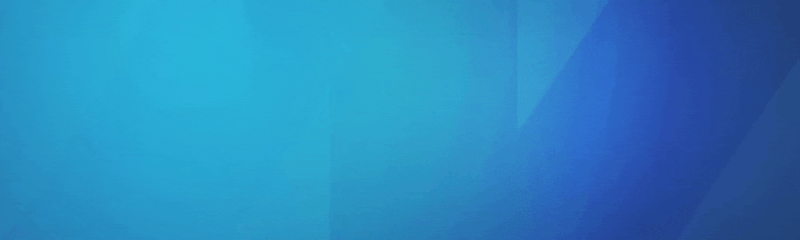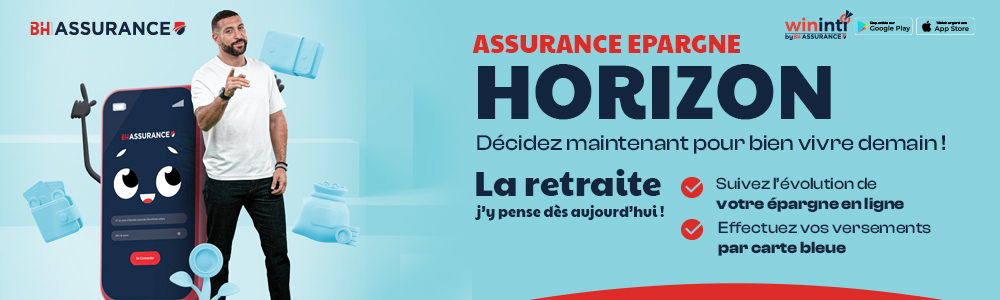Une découverte archéologique majeure en Tunisie vient profondément modifier notre compréhension de l’économie agricole de l’Empire romain. Sous la co-direction de l’Université Ca’ Foscari de Venise, en partenariat avec l’Université de La Manouba (Tunisie) et l’Université Complutense de Madrid, une équipe a mis au jour à Henchir el Begar, dans la région de Kasserine, le deuxième plus grand complexe de production d’huile d’olive jamais identifié dans l’Empire romain. Cette révélation transforme l’image d’une Afrique romaine périphérique en celle d’un centre névralgique de l’approvisionnement de Rome.
Un témoignage exceptionnel de l’industrialisation agricole antique
Le site de Henchir el Begar, situé au pied du massif du Jebel Semmama dans un environnement semi-aride, est divisé en deux secteurs principaux : Hr Begar 1 et Hr Begar 2 (Source : Communiqué de l’Université Ca’ Foscari). Le premier abrite douze presses à levier monumentales (torcularia), tandis que le second en compte huit, portant le total à vingt presses. Cette concentration place le complexe au second rang de tout le monde romain connu à ce jour.
L’ampleur des installations témoigne d’une logique de production industrielle. Les presses, actionnées par de grandes poutres de bois et des systèmes de contrepoids, étaient capables d’extraire plusieurs centaines de litres d’huile par jour. Cette production massive était destinée à répondre à la demande constante de Rome, où l’huile d’olive était une denrée stratégique pour l’alimentation, l’éclairage et les soins du corps.
Maîtrise technique et intégration impériale : le Saltus Beguensis
Le site est identifié comme étant l’antique Saltus Beguensis, un domaine appartenant à Lucillius Africanus, un vir clarissimus (membre de l’élite sénatoriale) (Source : Corpus Inscriptionum Latinarum CIL VIII, 1193 et 2358). Un décret sénatorial de 138 apr. J.-C. autorisait la tenue d’un marché bimestriel sur ce domaine, soulignant son importance socio-économique.
Cette découverte illustre parfaitement le lien direct entre le pouvoir impérial et l’exploitation intensive des ressources. Le domaine, structuré sur environ 33 hectares, possédait des infrastructures hydrauliques avancées – bassins de collecte, citernes interconnectées et canalisations – permettant de pallier le climat semi-aride. L’huile produite était vraisemblablement exportée vers Rome via le port de Carthage, intégrant pleinement cette région frontalière dans les circuits économiques impériaux.
Dynamiques sociales et économiques dans une zone frontalière
Au-delà des presses, les fouilles ont révélé l’existence d’un vicus rural, un village regroupant habitats, ateliers et structures communautaires (Source : Prospections géophysiques par géoradar). Ce village était probablement occupé par un mélange de colons, peut-être des vétérans, et de populations locales, comme les Musulamii, un peuple nomade numide.
L’analyse du matériel archéologique (meules, outils) indique une agriculture mixte, alliant oléiculture et céréaliculture. Cette polyvalence suggère une économie résiliente. La cohabitation observée à Henchir el Begar reflète les dynamiques sociales des provinces frontalières, où Rome consolidait son autorité par la mise en valeur des terres et l’intégration économique des communautés locales.
Une périphérie recentrée au cœur de l’Empire