Un taux d’investissement faible, et un potentiel inexploité
Avec un taux d’investissement (public et privé) de 16% entre 2020 et 2024, contre 19.3% en 2016, la Tunisie se place en queue du peloton des pays à revenus intermédiaires qui enregistrent un taux de 30%.
Le rapport sur l’examen de la politique d’investissement en Tunisie publié récemment par la CNUCED soulève plusieurs remarques et allume plus d’une lanterne rouge, sur l’attractivité de la Tunisie et la dynamique de l’investissement. Le rapport « offre une analyse approfondie du climat d’investissement du pays, avec des recommandations pour aligner les politiques sur les objectifs de développement durable ».
Un cadre général qui regorge d’anomalies et d’incohérences :
Selon ce rapport la Tunisie a réussi depuis les années 70 et principalement la loi 1972 sur le régime offshore à se positionner dans les chaines de valeur mondiale et à augmenter le niveau des exportations. Mais depuis quelques années les IDE stagnent et l’investissement privé est très faible au niveau de 12% du PIB, alors que l’investissement public est de 6% du PIB.
Jusqu’à la crise financière mondiale de 2008, les IDE ont atteint un sommet de 3,3 milliards de dollars en 2006. Ils ont, par la suite, graduellement diminué et se situent autour de 700 millions de dollars par an depuis 2020.
La Tunisie est placée en dernière position en termes d’IDE en comparaison avec d’autre pays similaires. Durant la période 2019-2023, la Tunisie a drainé en moyenne annuelle 728 Millions de dollars, contre 972 millions de dollars pour l’Algérie, 8245 Millions de dollars pour l’Egypte, 1752 Millions de dollars pour le Maroc, 841 millions de dollars pour la Jordanie et 2978 Millions de dollars pour le Costa Rica.
La loi 2016-71 sur l’investissement qui a remplacé le Code d’incitations aux investissements de 1993 a été votée en fanfare, avec des promesses de changement catégorique du climat de l’investissement en Tunisie. Elle a été complétée par des décrets déterminant le cadre institutionnel et les incitations financières. Malgré que cette loi a instauré le principe de la liberté et la transparence dans l’investissement, plusieurs activités économiques sont réglementées. Plusieurs activités demeurent restreintes aux étrangers.
Plusieurs réformes sont nécessaires à introduire dans le climat d’investissement en Tunisie que ce soit au niveau de la justice commerciale, l’accès au foncier, la politique de concurrence, l’emploi et le recrutement des étrangers, la politique fiscale, les procédures administratives pour la création d’entreprise,…..
Un investissement faible qui pénalise la croissance :
La baisse du taux d’investissement en Tunisie, ainsi que la réticence de certains investisseurs, pénalisent le niveau de croissance économique en Tunisie et par conséquent la création d’emplois. Le taux de chômage dépasse les 15% et touche principalement les jeunes et les femmes.
Un peu moins de la moitié (47 %) de la population en âge de travailler (15-64 ans) est active. Le manque de perspective au niveau de l’emploi « alimente aussi le secteur informel, qui représente 35 % du PIB et entre 27 % et 49 % des effectifs informels dans le total de l’emploi ». Le manque d’emplois participe aussi à la volonté des jeunes tunisiens à émigrer. « Ce sont ainsi près de 40 % des jeunes entre 15 et 29 ans qui expriment le souhait de quitter le pays, un taux qui augmente avec le niveau d’éducation ».
Selon le rapport, le manque d’investissement, public et privé, a ralenti aussi le processus d’industrialisation… Plus de 82 % des entreprises tunisiennes sont dans les services, dont à peu près la moitié dans le commerce et la réparation d’automobiles et de motocycles, et l’autre moitié dans les autres activités de services. La part des entreprises dans l’industrie a légèrement baissé, alors que celles de la construction et de l’agriculture ont un peu augmente. Une autre caractéristique du système productif tunisien est la taille des entreprises : en 2021, 88 % d’entre elles n’ont aucun salarié, 7 % ont entre un et deux salariés, et 0,4 % ont plus de 50 salariés.
La Tunisie a la part de valeur ajoutée locale dans les exportations la plus basse, avec 62%, contre 85% pour le Costa Rica, 75% pour le Maroc, et 68% pour la Jordanie.
Un potentiel inexploité :
Selon le rapport, un potentiel inexploité important est présent, à la fois en termes de nouveaux produits, en particulier en agriculture et dans les énergies renouvelables, mais également de marchés d’exportation. L’exploitation de ce potentiel nécessitera de surmonter les difficultés qui impactent l’investissement privé en ses trois composantes – local, étranger et de la diaspora. La complexité administrative caractérise le parcours de l’investisseur. Les procédures et les institutions qui en sont responsables sont nombreuses à l’entrée et à l’établissement, et pour l’accès au foncier, alors que la digitalisation reste limitée. Des restrictions sont présentes dans plusieurs activités, qui ne sont pas toujours en ligne avec les objectifs de développement du pays et le type d’activités économiques souhaitées. Par ailleurs, les conditions imposées par le code des changes compliquent les opérations des entreprises résidentes, offshore et onshore. Des imprécisions et un manque de ressources affectent le cadre juridique du travail, de l’environnement et de la concurrence, et rendent difficile la mise en œuvre des dispositions. Ceci est préoccupant notamment en raison de l’importance du secteur informel et les sécheresses à répétition qui affectent les récoltes agricoles et ajoutent aux difficultés d’approvisionnement de denrées essentielles. Enfin, des contraintes transversales et plus spécifiques à chaque type d’investissement limitent la capacité à pleinement tirer profit du potentiel du pays. La politique commerciale n’est pas en adéquation avec les objectifs du pays, et la dichotomie entre régimes offshore et onshore génère des distorsions entre entreprises. D’autre part, l’accès au financement constitue un obstacle majeur pour les entreprises tunisiennes et la promotion des investissements, effectuée par l’entremise de plusieurs institutions et avec des ressources limitées, devrait être renforcée.
Abou Farah


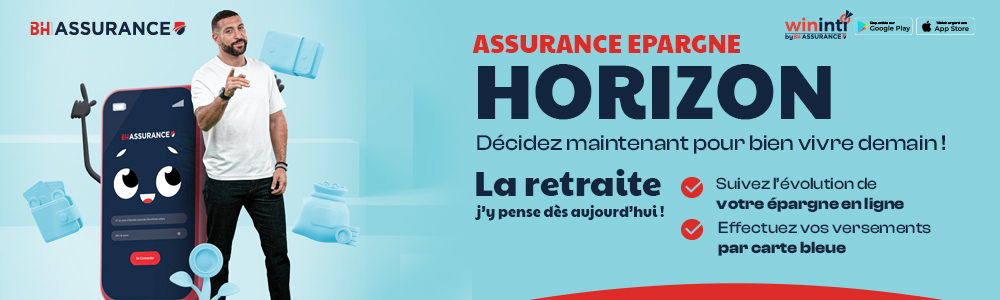








.jpg)




